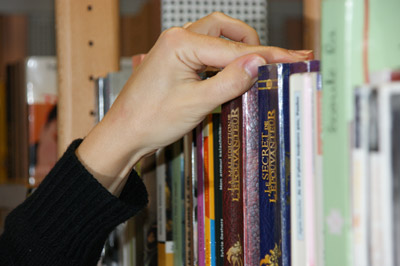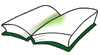[article]
| Titre : |
Actium ou la paix romaine |
| Type de document : |
texte imprimÃĐ |
| Auteurs : |
Maurice Sartre, Auteur |
| AnnÃĐe de publication : |
1992 |
| Article en page(s) : |
p. 32 Ã 36 |
| Langues : |
Français (fre) |
| CatÃĐgories : |
EntitÃĐs temporelles:PÃĐriodisations:AntiquitÃĐ:AntiquitÃĐ grÃĐco-romaine:AntiquitÃĐ romaine
|
| RÃĐsumÃĐ : |
A Actium, le 2 septembre 31 av. J.-C, Octave a vaincu Antoine : l'Occident romain a vaincu l'Orient. La MÃĐditerranÃĐe se trouve, pour la premiÃĻre fois, unifiÃĐe et pacifiÃĐe. Des colonnes d'Hercule au Bosphore et au delta du Nil, la ÂŦ Pax romana Âŧ rÃĻgne sans partage. Parce qu'elle a su associer les notables provinciaux à la gestion de l'Empire.
Actium : un promontoire aride à l'entrÃĐe du golfe d'Ambracie sur la cÃīte occidentale de la GrÃĻce. Là s'ÃĐlÃĻve un sanctuaire d'Apollon Aktios oÃđ les Acarnaniens avaient l'habitude de cÃĐlÃĐbrer chaque annÃĐe des concours en l'honneur du dieu. Depuis les guerres du IIe siÃĻcle av. J.-C. qui ont vu les armÃĐes romaines piller l'Ãpire et la GrÃĻce de l'Ouest, l'endroit est peu frÃĐquentÃĐ. Seule la position du cap, sur la route de l'Italie et de la Sicile, lui vaut d'Être encore connu des marins qui relÃĒchent, par mauvais temps, dans les eaux calmes du golfe.
C'est là que le 2 septembre 31 av. J.-C. se livre la bataille dÃĐcisive qui met fin aux guerres civiles à Rome et ouvre la voie à l'annexion du dernier royaume hellÃĐnistique, l'Egypte. Certes, l'histoire ne se joue pas en un jour : Actium n'est que l'aboutissement (avant la prise d'Alexandrie le 1er aoÃŧt de l'annÃĐe suivante) d'une campagne oÃđ Marc Antoine, gÃĐnÃĐral romain qui, maÃŪtre de l'Orient, avait fini, disait Octave, par faire siens les intÃĐrÊts de l'Egypte, au dÃĐtriment de ceux de l'Empire, a laissÃĐ passer sa chance. Si militairement tout est jouÃĐ Ã Actium, politiquement tout reste à faire : aprÃĻs la victoire d'Octave qui tient l'Occident de l'Empire et affirme dÃĐfendre l'unitÃĐ des territoires romains, il fallut des annÃĐes pour que se mette en place une nouvelle organisation politique. Instant privilÃĐgiÃĐ d'un long processus, Actium symbolise, depuis l'AntiquitÃĐ, le passage de la guerre à la paix, de la dÃĐsunion à l'unification politique de toute la MÃĐditerranÃĐe, la seule qu'elle ait jamais connue.
Depuis la fin du IIIe siÃĻcle av. J.-C, Rome avait ÃĐtendu son autoritÃĐ Ã la fois sur l'ensemble de la pÃĐninsule italienne et sur les rivages de la MÃĐditerranÃĐe. Cette extension, commencÃĐe en Occident par la conquÊte de la Sicile (241 av. J.-C), de la Sardaigne (236 av. J.-C.) et de l'Espagne (197 av. J.-C), s'est poursuivie conjointement dans les deux bassins de la MÃĐditerranÃĐe. Elle s'est accÃĐlÃĐrÃĐe depuis le milieu du IIe siÃĻcle avant notre ÃĻre avec la crÃĐation des provinces de MacÃĐdoine (148 av. J.-C), d'Afrique (146 av. J.-C), d'Asie (133-129 av. J.-C), et de Narbonnaise.
Luttant à la fois contre les pirates qui infestent toute la MÃĐditerranÃĐe et contre le roi du Pont, Mithridate VI Eupator, dont les entreprises mettent en pÃĐril la prÃĐsence romaine en Asie et en GrÃĻce [1], Rome ne cesse d'ÃĐtendre son autoritÃĐ et de crÃĐer de nouvelles provinces en Orient : Cilicie (vers 96 av. J.-C), Bithynie-Pont (74 av. J.-C), Syrie (64 av. J.-C), Chypre (59 av. J.-C). Ainsi disparaissent les royaumes dits ÂŦ hellÃĐnistiques Âŧ, hÃĐritÃĐs des conquÊtes d'Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C), et ceux qui s'ÃĐtaient constituÃĐs sur leurs marges. Presque partout, Rome s'approprie l'espace en installant une administration provinciale rÃĐduite, chargÃĐe essentiellement de maintenir l'ordre et de faire rentrer l'impÃīt. Ainsi, lorsque Marc Antoine et Octave, associÃĐs à LÃĐpide au sein du Second Triumvirat [2] (octobre 43 av. J.-C), s'ÃĐrigent en vengeurs de CÃĐsar assassinÃĐ, la quasi-totalitÃĐ des rivages de la MÃĐditerranÃĐe obÃĐit à Rome, à l'exception du royaume lagide, rÃĐduit à l'Egypte [3]. Actium ne marque donc que l'achÃĻvement d'une conquÊte dÃĐjà rÃĐalisÃĐe pour l'essentiel.
Cependant, dans les annÃĐes 30 avant notre ÃĻre, cette hÃĐgÃĐmonie de Rome est encore rÃĐpartie entre des maÃŪtres rivaux. En octobre 42 av. J.-C, les triumvirs s'ÃĐtaient partagÃĐ le monde : à Octave l'Occident, à LÃĐpide l'Afrique, à Marc Antoine l'Orient, tandis que l'Italie restait le bien commun oÃđ chacun pourrait recruter des troupes. En 39 av. J.-C, il fallut faire une place à Sextus PompÃĐe, le fils du ÂŦ Grand PompÃĐe Âŧ rival de CÃĐsar, qui reçut les ÃŪles (Sicile, Sardaigne, Corse) et l'AchaÃŊe (au nord du PÃĐloponnÃĻse). Depuis lors, Octave ÃĐtait parvenu à reconstituer l'unitÃĐ du bassin occidental en ÃĐliminant d'abord LÃĐpide, puis Sextus PompÃĐe (vaincu à Nauloque en 36 av. J.-C). On en revenait à un partage du monde entre deux imperatores dont la brouille, prÃĐvisible dÃĻs la fin 34 av. J.-C, devint ÃĐvidente en fÃĐvrier-mars 32 av. J.-C. |
in L'histoire > N° 157 (Juillet-AoÃŧt 1992) . - p. 32 à 36
[article] Actium ou la paix romaine [texte imprimÃĐ] / Maurice Sartre, Auteur . - 1992 . - p. 32 à 36. Langues : Français ( fre) in L'histoire > N° 157 (Juillet-AoÃŧt 1992) . - p. 32 à 36
| CatÃĐgories : |
EntitÃĐs temporelles:PÃĐriodisations:AntiquitÃĐ:AntiquitÃĐ grÃĐco-romaine:AntiquitÃĐ romaine
|
| RÃĐsumÃĐ : |
A Actium, le 2 septembre 31 av. J.-C, Octave a vaincu Antoine : l'Occident romain a vaincu l'Orient. La MÃĐditerranÃĐe se trouve, pour la premiÃĻre fois, unifiÃĐe et pacifiÃĐe. Des colonnes d'Hercule au Bosphore et au delta du Nil, la ÂŦ Pax romana Âŧ rÃĻgne sans partage. Parce qu'elle a su associer les notables provinciaux à la gestion de l'Empire.
Actium : un promontoire aride à l'entrÃĐe du golfe d'Ambracie sur la cÃīte occidentale de la GrÃĻce. Là s'ÃĐlÃĻve un sanctuaire d'Apollon Aktios oÃđ les Acarnaniens avaient l'habitude de cÃĐlÃĐbrer chaque annÃĐe des concours en l'honneur du dieu. Depuis les guerres du IIe siÃĻcle av. J.-C. qui ont vu les armÃĐes romaines piller l'Ãpire et la GrÃĻce de l'Ouest, l'endroit est peu frÃĐquentÃĐ. Seule la position du cap, sur la route de l'Italie et de la Sicile, lui vaut d'Être encore connu des marins qui relÃĒchent, par mauvais temps, dans les eaux calmes du golfe.
C'est là que le 2 septembre 31 av. J.-C. se livre la bataille dÃĐcisive qui met fin aux guerres civiles à Rome et ouvre la voie à l'annexion du dernier royaume hellÃĐnistique, l'Egypte. Certes, l'histoire ne se joue pas en un jour : Actium n'est que l'aboutissement (avant la prise d'Alexandrie le 1er aoÃŧt de l'annÃĐe suivante) d'une campagne oÃđ Marc Antoine, gÃĐnÃĐral romain qui, maÃŪtre de l'Orient, avait fini, disait Octave, par faire siens les intÃĐrÊts de l'Egypte, au dÃĐtriment de ceux de l'Empire, a laissÃĐ passer sa chance. Si militairement tout est jouÃĐ Ã Actium, politiquement tout reste à faire : aprÃĻs la victoire d'Octave qui tient l'Occident de l'Empire et affirme dÃĐfendre l'unitÃĐ des territoires romains, il fallut des annÃĐes pour que se mette en place une nouvelle organisation politique. Instant privilÃĐgiÃĐ d'un long processus, Actium symbolise, depuis l'AntiquitÃĐ, le passage de la guerre à la paix, de la dÃĐsunion à l'unification politique de toute la MÃĐditerranÃĐe, la seule qu'elle ait jamais connue.
Depuis la fin du IIIe siÃĻcle av. J.-C, Rome avait ÃĐtendu son autoritÃĐ Ã la fois sur l'ensemble de la pÃĐninsule italienne et sur les rivages de la MÃĐditerranÃĐe. Cette extension, commencÃĐe en Occident par la conquÊte de la Sicile (241 av. J.-C), de la Sardaigne (236 av. J.-C.) et de l'Espagne (197 av. J.-C), s'est poursuivie conjointement dans les deux bassins de la MÃĐditerranÃĐe. Elle s'est accÃĐlÃĐrÃĐe depuis le milieu du IIe siÃĻcle avant notre ÃĻre avec la crÃĐation des provinces de MacÃĐdoine (148 av. J.-C), d'Afrique (146 av. J.-C), d'Asie (133-129 av. J.-C), et de Narbonnaise.
Luttant à la fois contre les pirates qui infestent toute la MÃĐditerranÃĐe et contre le roi du Pont, Mithridate VI Eupator, dont les entreprises mettent en pÃĐril la prÃĐsence romaine en Asie et en GrÃĻce [1], Rome ne cesse d'ÃĐtendre son autoritÃĐ et de crÃĐer de nouvelles provinces en Orient : Cilicie (vers 96 av. J.-C), Bithynie-Pont (74 av. J.-C), Syrie (64 av. J.-C), Chypre (59 av. J.-C). Ainsi disparaissent les royaumes dits ÂŦ hellÃĐnistiques Âŧ, hÃĐritÃĐs des conquÊtes d'Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C), et ceux qui s'ÃĐtaient constituÃĐs sur leurs marges. Presque partout, Rome s'approprie l'espace en installant une administration provinciale rÃĐduite, chargÃĐe essentiellement de maintenir l'ordre et de faire rentrer l'impÃīt. Ainsi, lorsque Marc Antoine et Octave, associÃĐs à LÃĐpide au sein du Second Triumvirat [2] (octobre 43 av. J.-C), s'ÃĐrigent en vengeurs de CÃĐsar assassinÃĐ, la quasi-totalitÃĐ des rivages de la MÃĐditerranÃĐe obÃĐit à Rome, à l'exception du royaume lagide, rÃĐduit à l'Egypte [3]. Actium ne marque donc que l'achÃĻvement d'une conquÊte dÃĐjà rÃĐalisÃĐe pour l'essentiel.
Cependant, dans les annÃĐes 30 avant notre ÃĻre, cette hÃĐgÃĐmonie de Rome est encore rÃĐpartie entre des maÃŪtres rivaux. En octobre 42 av. J.-C, les triumvirs s'ÃĐtaient partagÃĐ le monde : à Octave l'Occident, à LÃĐpide l'Afrique, à Marc Antoine l'Orient, tandis que l'Italie restait le bien commun oÃđ chacun pourrait recruter des troupes. En 39 av. J.-C, il fallut faire une place à Sextus PompÃĐe, le fils du ÂŦ Grand PompÃĐe Âŧ rival de CÃĐsar, qui reçut les ÃŪles (Sicile, Sardaigne, Corse) et l'AchaÃŊe (au nord du PÃĐloponnÃĻse). Depuis lors, Octave ÃĐtait parvenu à reconstituer l'unitÃĐ du bassin occidental en ÃĐliminant d'abord LÃĐpide, puis Sextus PompÃĐe (vaincu à Nauloque en 36 av. J.-C). On en revenait à un partage du monde entre deux imperatores dont la brouille, prÃĐvisible dÃĻs la fin 34 av. J.-C, devint ÃĐvidente en fÃĐvrier-mars 32 av. J.-C. |
|