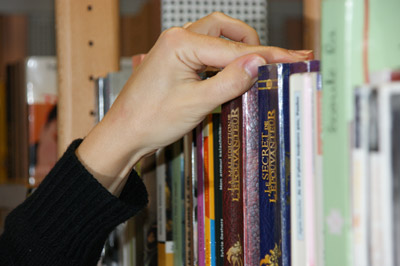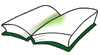| Titre : |
ArchÃĐologie d'une communautÃĐ de sidÃĐrurgistes d'Afrique subsaharienne : Savoirs, techniques et histoire des forgerons de BitchabÃĐ (Pays Bassar, Nord-Togo) : ThÃĻse de doctorat unique spÃĐcialitÃĐ : ArchÃĐologie Africaine |
| Type de document : |
texte imprimÃĐ |
| Auteurs : |
Lebarama Bakrobena, Auteur |
| Editeur : |
LomÃĐ [Togo] : UniversitÃĐ de LomÃĐ |
| AnnÃĐe de publication : |
2020 |
| Importance : |
1 vol. (XIII+428 p.) |
| PrÃĐsentation : |
ill. |
| Format : |
30 cm |
| Langues : |
Français (fre) |
| CatÃĐgories : |
Aire gÃĐographique:Afrique:Afrique sub-saharienne:Afrique de l'Ouest:Togo
ThÃĐmatique:Technologie:Ãlaboration:MÃĐtallurgie:Fer
ThÃĐmatique:Technologie:Transformation:MÃĐtallurgie:Fer
|
| Mots-clÃĐs : |
Outils marteau enclume tuyÃĻre |
| RÃĐsumÃĐ : |
Le fer tient une place particulieĖre en Afrique subsaharienne. Au Togo les sideĖrurgistes bassar ont joueĖ un roĖle important dans lâhistoire de lâeĖconomie et des techniques. Ce rayonnement technique et eĖconomique des sideĖrurgistes bassar a surpris les EuropeĖens qui ont visiteĖ cette zone du Togo pour la premieĖre fois. Dâailleurs, les toponymes que portent certains villages (BitchabeĖ = ââles forgeronsââ, BitchalambeĖ = ââles forgerons-chanteursââ) et la diversiteĖ des vestiges sideĖrurgiques que lâon rencontre cĖ§aĖ et laĖ sont des preuves tangibles de lâimportance de cette activiteĖ.
Seuls teĖmoins tangibles de ces savoirs et techniques des sideĖrurgistes bassar, les vestiges sideĖrurgiques se deĖgradent malheureusement (avec les actions conjugueĖes de la nature et de lâhomme) apreĖs la cessation de cette activiteĖ il y a plus dâun demi-sieĖcle alors que son histoire reste encore peu ou mal appreĖhendeĖe. La preĖsente recherche se propose dâeĖtudier les savoirs et les techniques des forgerons de BitchabeĖ ; lâun des importants foyers qui sâest speĖcialiseĖ dans la production dâoutils meĖtalliques entre la fin du XVIIeĖ et la moitieĖ du XXeĖ sieĖcle. Elle sâinteĖresse eĖgalement aĖ lâhistoire de ces artisans et propose des meĖcanismes permettant de sauvegarder ces vestiges sideĖrurgiques incontournables du patrimoine culturel du pays bassar.
Pour y parvenir nous avons meneĖ des recherches documentaires. Nous avons meneĖ eĖgalement des recherches sur le terrain. Ces dernieĖres ont concerneĖ les enqueĖtes ethnohistoriques, les prospections et les fouilles archeĖologiques. Certains vestiges exhumeĖs des fouilles notamment le charbon a eĖteĖ dateĖ dans des laboratoires speĖcialiseĖs. Les reĖsultats obtenus ont eĖteĖ regroupeĖs dans trois parties composeĖes de six chapitres.
La maiĖtrise de la chaiĖne opeĖratoire en sideĖrurgie a eĖvolueĖ en pays bassar selon les eĖpoques. Au cours de la peĖriode juste avant et pendant la colonisation, lâeĖpuration et la fabrication des outils meĖtalliques eĖtaient reĖaliseĖes aĖ BitchabeĖ. Le choix des outils lithiques pour forger le meĖtal sâexplique non seulement par la volonteĖ de conserver les traditions techniques mais eĖgalement par les difficulteĖs techniques lieĖes aĖ la chaiĖne opeĖratoire et aĖ la morphologie des outils fabriqueĖs. Par ailleurs, les prospections archeĖologiques ont permis de reĖpertorier plusieurs sites et vestiges qui ont eĖteĖ cartographieĖs.
La caracteĖrisation des scories de forge exhumeĖes a permis de distinguer quatre types : scories argilo-sableuses (SAS), scories grises danses (SGD), scories informes (SI) et scories ferrugineuses rouilleĖes (SFR). La forte proportion des SGD (64,81%) et la faible proportion des SFR (3,33%) sont les preuves dâune bonne maiĖtrise des techniques de forgeage par les artisans de BitchabeĖ.
De meĖme le site fouilleĖ suggeĖre deux occupations graĖce aĖ lâanalyse des tessons de poterie exhumeĖs : la premieĖre occupation se situe entre le XIVeĖ et le XVIeĖ sieĖcle alors que la deuxieĖme occupation est situeĖe entre la fin du XVIeĖ et le XVIIIeĖ sieĖcle. Ceci concorde plus ou moins avec la date carbone 14 obtenue qui situe le site entre la fin du XIIIeĖ sieĖcle et le XIVeĖ sieĖcle (1276-1392 cal. AD). Ainsi, nous pouvons confirmer que la forge eĖtait anciennement pratiqueĖe et treĖs certainement aĖ la meĖme eĖpoque que la reĖduction du fer.
Enfin, lâanalyse de lâhistoire du peuplement de BitchabeĖ suggeĖre un fond de peuplement ancien sur lequel de vagues de migrants venus dâhorizons divers se sont greffeĖs aĖ partir du XVIeĖ sieĖcle. Par ailleurs, les menaces qui peĖsent sur le patrimoine sideĖrurgique bassar sont naturelles et humaines. Cependant, des actions de sauvegarde sont neĖcessaires pour valoriser ce riche patrimoine aupreĖs des geĖneĖrations futures qui pourraient sâen inspirer. |
ArchÃĐologie d'une communautÃĐ de sidÃĐrurgistes d'Afrique subsaharienne : Savoirs, techniques et histoire des forgerons de BitchabÃĐ (Pays Bassar, Nord-Togo) : ThÃĻse de doctorat unique spÃĐcialitÃĐ : ArchÃĐologie Africaine [texte imprimÃĐ] / Lebarama Bakrobena, Auteur . - LomÃĐ [Togo] : UniversitÃĐ de LomÃĐ, 2020 . - 1 vol. (XIII+428 p.) : ill. ; 30 cm. Langues : Français ( fre)
| CatÃĐgories : |
Aire gÃĐographique:Afrique:Afrique sub-saharienne:Afrique de l'Ouest:Togo
ThÃĐmatique:Technologie:Ãlaboration:MÃĐtallurgie:Fer
ThÃĐmatique:Technologie:Transformation:MÃĐtallurgie:Fer
|
| Mots-clÃĐs : |
Outils marteau enclume tuyÃĻre |
| RÃĐsumÃĐ : |
Le fer tient une place particulieĖre en Afrique subsaharienne. Au Togo les sideĖrurgistes bassar ont joueĖ un roĖle important dans lâhistoire de lâeĖconomie et des techniques. Ce rayonnement technique et eĖconomique des sideĖrurgistes bassar a surpris les EuropeĖens qui ont visiteĖ cette zone du Togo pour la premieĖre fois. Dâailleurs, les toponymes que portent certains villages (BitchabeĖ = ââles forgeronsââ, BitchalambeĖ = ââles forgerons-chanteursââ) et la diversiteĖ des vestiges sideĖrurgiques que lâon rencontre cĖ§aĖ et laĖ sont des preuves tangibles de lâimportance de cette activiteĖ.
Seuls teĖmoins tangibles de ces savoirs et techniques des sideĖrurgistes bassar, les vestiges sideĖrurgiques se deĖgradent malheureusement (avec les actions conjugueĖes de la nature et de lâhomme) apreĖs la cessation de cette activiteĖ il y a plus dâun demi-sieĖcle alors que son histoire reste encore peu ou mal appreĖhendeĖe. La preĖsente recherche se propose dâeĖtudier les savoirs et les techniques des forgerons de BitchabeĖ ; lâun des importants foyers qui sâest speĖcialiseĖ dans la production dâoutils meĖtalliques entre la fin du XVIIeĖ et la moitieĖ du XXeĖ sieĖcle. Elle sâinteĖresse eĖgalement aĖ lâhistoire de ces artisans et propose des meĖcanismes permettant de sauvegarder ces vestiges sideĖrurgiques incontournables du patrimoine culturel du pays bassar.
Pour y parvenir nous avons meneĖ des recherches documentaires. Nous avons meneĖ eĖgalement des recherches sur le terrain. Ces dernieĖres ont concerneĖ les enqueĖtes ethnohistoriques, les prospections et les fouilles archeĖologiques. Certains vestiges exhumeĖs des fouilles notamment le charbon a eĖteĖ dateĖ dans des laboratoires speĖcialiseĖs. Les reĖsultats obtenus ont eĖteĖ regroupeĖs dans trois parties composeĖes de six chapitres.
La maiĖtrise de la chaiĖne opeĖratoire en sideĖrurgie a eĖvolueĖ en pays bassar selon les eĖpoques. Au cours de la peĖriode juste avant et pendant la colonisation, lâeĖpuration et la fabrication des outils meĖtalliques eĖtaient reĖaliseĖes aĖ BitchabeĖ. Le choix des outils lithiques pour forger le meĖtal sâexplique non seulement par la volonteĖ de conserver les traditions techniques mais eĖgalement par les difficulteĖs techniques lieĖes aĖ la chaiĖne opeĖratoire et aĖ la morphologie des outils fabriqueĖs. Par ailleurs, les prospections archeĖologiques ont permis de reĖpertorier plusieurs sites et vestiges qui ont eĖteĖ cartographieĖs.
La caracteĖrisation des scories de forge exhumeĖes a permis de distinguer quatre types : scories argilo-sableuses (SAS), scories grises danses (SGD), scories informes (SI) et scories ferrugineuses rouilleĖes (SFR). La forte proportion des SGD (64,81%) et la faible proportion des SFR (3,33%) sont les preuves dâune bonne maiĖtrise des techniques de forgeage par les artisans de BitchabeĖ.
De meĖme le site fouilleĖ suggeĖre deux occupations graĖce aĖ lâanalyse des tessons de poterie exhumeĖs : la premieĖre occupation se situe entre le XIVeĖ et le XVIeĖ sieĖcle alors que la deuxieĖme occupation est situeĖe entre la fin du XVIeĖ et le XVIIIeĖ sieĖcle. Ceci concorde plus ou moins avec la date carbone 14 obtenue qui situe le site entre la fin du XIIIeĖ sieĖcle et le XIVeĖ sieĖcle (1276-1392 cal. AD). Ainsi, nous pouvons confirmer que la forge eĖtait anciennement pratiqueĖe et treĖs certainement aĖ la meĖme eĖpoque que la reĖduction du fer.
Enfin, lâanalyse de lâhistoire du peuplement de BitchabeĖ suggeĖre un fond de peuplement ancien sur lequel de vagues de migrants venus dâhorizons divers se sont greffeĖs aĖ partir du XVIeĖ sieĖcle. Par ailleurs, les menaces qui peĖsent sur le patrimoine sideĖrurgique bassar sont naturelles et humaines. Cependant, des actions de sauvegarde sont neĖcessaires pour valoriser ce riche patrimoine aupreĖs des geĖneĖrations futures qui pourraient sâen inspirer. |
|


 Affiner la recherche
Affiner la rechercheArchÃĐologie d'une communautÃĐ de sidÃĐrurgistes d'Afrique subsaharienne : Savoirs, techniques et histoire des forgerons de BitchabÃĐ (Pays Bassar, Nord-Togo) / Lebarama Bakrobena
116 - Juin 2009 - ArchÃĐologie expÃĐrimentale du bas fourneau : rÃĐduction et post-rÃĐduction du fer (Bulletin de Les nouvelles de l'archÃĐologie) / Danielle Arribet-Deroin

Baelen/Baelen : artisanat palÃĐomÃĐtallurgique à "Horren" / Heike Fock in Chronique de l'archÃĐologie wallonne, N°21 (2012)
Cantons de Conques, Estaing, Marcillac-Vallon : Mines et mÃĐtallurgies antiques dans l arÃĐgion de Kaymar / Philippe Abraham in Cahiers d'archÃĐologie aveyronnaise, N° 12 (1998)
La Champagne, vieille terre de mÃĐtallurgie (une proto-industrie, la mÃĐtallurgie du fer dans la gÃĐnÃĐralitÃĐ de ChÃĒlons) / Ãdith ClÃĐment in Ãtudes marnaises, T. CXXXVIII (2023)
La construction du chemin de fer Namur-Givet / Jean-Pierre Hamblenne in Ardenne Wallonne, N°46 (Septembre 1991)
L'ÃĻre du fer en Luxembourg (XVe-XIXe siÃĻcles) : Ãtudes relatives à l'ancienne sidÃĐrurgie et à d'autres industries au Luxembourg / Marcel Bourguignon


La fouille archÃĐologique du VÃŪ Fournia (Commune de Thilay) / Maxence Pieters in Terres ardennaises, N°165 (DÃĐcembre 2023)
Fouille du huat fourneau de Marsolle (comm. de Saint-Hubert) / Jean-Pol Weber in Archaeologia belgica - Nouvelle sÃĐrie, N°3 (1987)
Linchamps et la mÃĐtallurgie, toute une histoireâĶ in Le Pays des Hautes RiviÃĻres, N°010 (DeuxiÃĻme semestre 2016)