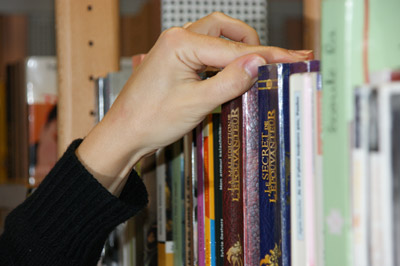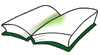CARA
DĂ©tail de l'auteur
Auteur Jean-Paul Thuillier |
Documents disponibles écrits par cet auteur (3)


 Affiner la recherche
Affiner la recherche
Titre : La fin des Etrusques Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Paul Thuillier, Auteur Année de publication : 1991 Article en page(s) : p. 8 à 16 Langues : Français (fre) Catégories : Entités temporelles:Périodisations:Antiquité:Antiquité gréco-romaine:Antiquité romaine Résumé :
Les prêtres étrusques avaient prédit la mort de leur propre civilisation. Une civilisation méconnue, dont l'essor a inspiré les hypothèses les plus hasardeuses, et qui a fini par succomber aux assauts de Rome. Pourquoi cette extraordinaire expansion, et ce déclin rapide ?
Dans l'Antiquité déjà , c'était un lieu commun que de parler de la religiosité des Étrusques : les Romains étaient frappés par ce trait de leurs voisins. L'historien Tite-Live n'écrit-il pas que « cette nation était attachée plus que toute autre aux pratiques religieuses, d'autant plus qu'elle avait une compétence spéciale en ce domaine » ? On n'hésitait pas à illustrer cette réalité par des étymologies fantaisistes dont les Anciens étaient friands : le nom latin des Étrusques, Tusci (à l'origine de la Tosca-ne) [1], était rattaché au verbe grec thuein (« sacrifier ») ; et la ville de Caeré, une des plus grandes cités étrusques, l'actuelle Cerveteri, au nord de Rome (cf. carte, p. 11), serait à l'origine du mot caerimoniae..
in L'histoire > N° 144 (Mai 1991) . - p. 8 à 16[article] La fin des Etrusques [texte imprimĂ©] / Jean-Paul Thuillier, Auteur . - 1991 . - p. 8 Ă 16.
Langues : Français (fre)
in L'histoire > N° 144 (Mai 1991) . - p. 8 à 16
Catégories : Entités temporelles:Périodisations:Antiquité:Antiquité gréco-romaine:Antiquité romaine Résumé :
Les prêtres étrusques avaient prédit la mort de leur propre civilisation. Une civilisation méconnue, dont l'essor a inspiré les hypothèses les plus hasardeuses, et qui a fini par succomber aux assauts de Rome. Pourquoi cette extraordinaire expansion, et ce déclin rapide ?
Dans l'Antiquité déjà , c'était un lieu commun que de parler de la religiosité des Étrusques : les Romains étaient frappés par ce trait de leurs voisins. L'historien Tite-Live n'écrit-il pas que « cette nation était attachée plus que toute autre aux pratiques religieuses, d'autant plus qu'elle avait une compétence spéciale en ce domaine » ? On n'hésitait pas à illustrer cette réalité par des étymologies fantaisistes dont les Anciens étaient friands : le nom latin des Étrusques, Tusci (à l'origine de la Tosca-ne) [1], était rattaché au verbe grec thuein (« sacrifier ») ; et la ville de Caeré, une des plus grandes cités étrusques, l'actuelle Cerveteri, au nord de Rome (cf. carte, p. 11), serait à l'origine du mot caerimoniae..
Titre : La fondation de Carthage Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Paul Thuillier, Auteur Année de publication : 1993 Article en page(s) : p. 14 à 19 Langues : Français (fre) Catégories : Entités temporelles:Périodisations:Antiquité:Carthage Résumé :
En quelle année Carthage a-t-elle été fondée par des Phéniciens venus de tyr ? Quel crédit faut-il accorder à la légende selon laquelle la reine Élissa aurait choisi ce site à l'exclusion de tout autre ? Comment la ville s'est-elle peu à peu développée au point de porter ombrage à Rome ? A ces questions, les fouilles entreprises depuis quelques années sous l'égide de l'UNESCO permettent d'apporter enfin des réponses précises.
Les fouilles archéologiques menées depuis quelques années en Tunisie ont révolutionné l'idée que l'on se faisait jusqu'ici de la fondation de Carthage. Ce qu'elles nous ont apporté ? Essentiellement la certitude que la légende, puis les récits des Anciens nous disaient - à peu près - la vérité sur l'origine de la ville1.
in L'histoire > N° 170 (Octobre 1993) . - p. 14 à 19[article] La fondation de Carthage [texte imprimĂ©] / Jean-Paul Thuillier, Auteur . - 1993 . - p. 14 Ă 19.
Langues : Français (fre)
in L'histoire > N° 170 (Octobre 1993) . - p. 14 à 19
Catégories : Entités temporelles:Périodisations:Antiquité:Carthage Résumé :
En quelle année Carthage a-t-elle été fondée par des Phéniciens venus de tyr ? Quel crédit faut-il accorder à la légende selon laquelle la reine Élissa aurait choisi ce site à l'exclusion de tout autre ? Comment la ville s'est-elle peu à peu développée au point de porter ombrage à Rome ? A ces questions, les fouilles entreprises depuis quelques années sous l'égide de l'UNESCO permettent d'apporter enfin des réponses précises.
Les fouilles archéologiques menées depuis quelques années en Tunisie ont révolutionné l'idée que l'on se faisait jusqu'ici de la fondation de Carthage. Ce qu'elles nous ont apporté ? Essentiellement la certitude que la légende, puis les récits des Anciens nous disaient - à peu près - la vérité sur l'origine de la ville1.Les lamelles d'Or de Pyrgi ou les secrets du Monde Etrusque / Jean-Paul Thuillier in L'histoire, N° 155 (Mai 1992)
Titre : Les lamelles d'Or de Pyrgi ou les secrets du Monde Etrusque Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Paul Thuillier, Auteur Année de publication : 1992 Article en page(s) : p. 84 à 86 Langues : Français (fre) Catégories : Entités temporelles:Périodisations:Antiquité:Époque étrusque Résumé :
Le Grand Palais accueillera à l'automne 1992 une exposition consacrée aux Étrusques. On connaît surtout ce peuple de l'Italie centrale par les témoignages archéologiques qu'il nous a laissés. Sa langue, en revanche, nous reste largement obscure. Et pourtant, la découverte à Pyrgi de trois lamelles d'or gravées en étrusque et en phénicien avait fait naître un grand espoir*.
1964 : on découvre à Pyrgi, port de Caeré - une des plus grandes cités-États étrusques, l'actuelle Cer-veteri -, trois lamelles d'or portant des inscriptions en étrusque et en phénicien. La nouvelle suscite l'enthousiasme chez les savants : grâce à cette nouvelle « pierre de Rosette », pourrait-on enfin déchiffrer l'étrusque, cette langue de l'Italie centrale antique encore largement inconnue ?
La déception fut presque immédiate. Les textes étrusques et phéniciens n'étaient en effet pas identiques ; ils parlaient du même événement, mais n'étaient pas le décalque l'un de l'autre. En outre, le phénicien ne se laisse pas facilement traduire et les spécialistes ont proposé plusieurs interprétations du texte. Quelques progrès ont néanmoins été réalisés grâce à ces lamelles : par exemple on sait désormais que le chiffre trois se dit « ci » en étrusque, un terme qui montre bien que cette langue n'est pas indo-européenne.
in L'histoire > N° 155 (Mai 1992) . - p. 84 à 86[article] Les lamelles d'Or de Pyrgi ou les secrets du Monde Etrusque [texte imprimĂ©] / Jean-Paul Thuillier, Auteur . - 1992 . - p. 84 Ă 86.
Langues : Français (fre)
in L'histoire > N° 155 (Mai 1992) . - p. 84 à 86
Catégories : Entités temporelles:Périodisations:Antiquité:Époque étrusque Résumé :
Le Grand Palais accueillera à l'automne 1992 une exposition consacrée aux Étrusques. On connaît surtout ce peuple de l'Italie centrale par les témoignages archéologiques qu'il nous a laissés. Sa langue, en revanche, nous reste largement obscure. Et pourtant, la découverte à Pyrgi de trois lamelles d'or gravées en étrusque et en phénicien avait fait naître un grand espoir*.
1964 : on découvre à Pyrgi, port de Caeré - une des plus grandes cités-États étrusques, l'actuelle Cer-veteri -, trois lamelles d'or portant des inscriptions en étrusque et en phénicien. La nouvelle suscite l'enthousiasme chez les savants : grâce à cette nouvelle « pierre de Rosette », pourrait-on enfin déchiffrer l'étrusque, cette langue de l'Italie centrale antique encore largement inconnue ?
La déception fut presque immédiate. Les textes étrusques et phéniciens n'étaient en effet pas identiques ; ils parlaient du même événement, mais n'étaient pas le décalque l'un de l'autre. En outre, le phénicien ne se laisse pas facilement traduire et les spécialistes ont proposé plusieurs interprétations du texte. Quelques progrès ont néanmoins été réalisés grâce à ces lamelles : par exemple on sait désormais que le chiffre trois se dit « ci » en étrusque, un terme qui montre bien que cette langue n'est pas indo-européenne.